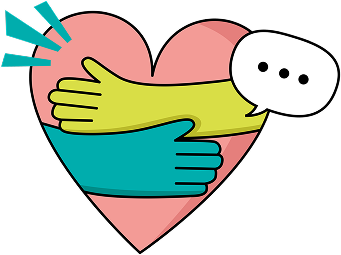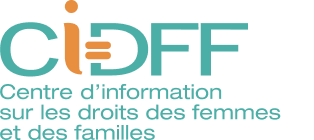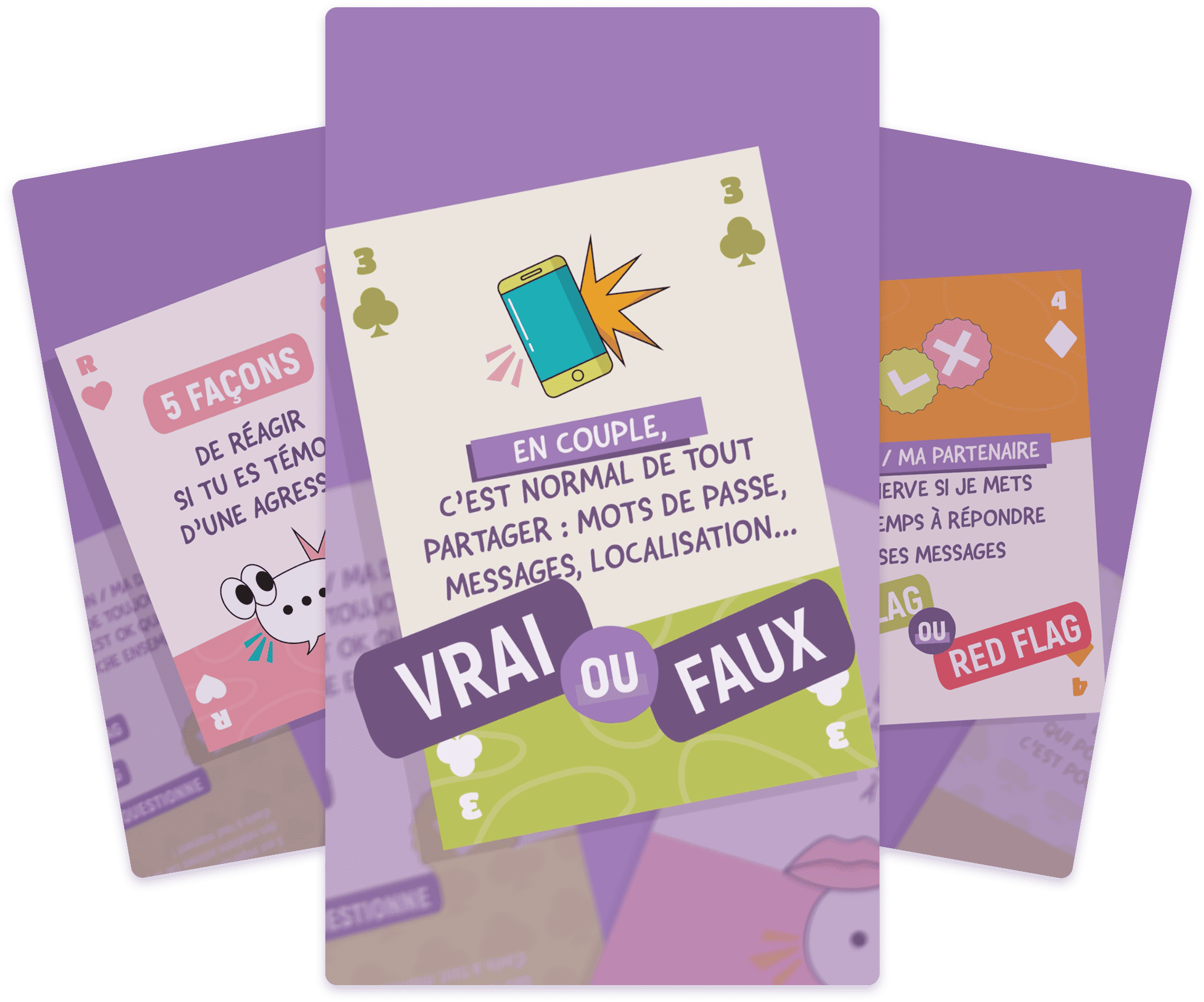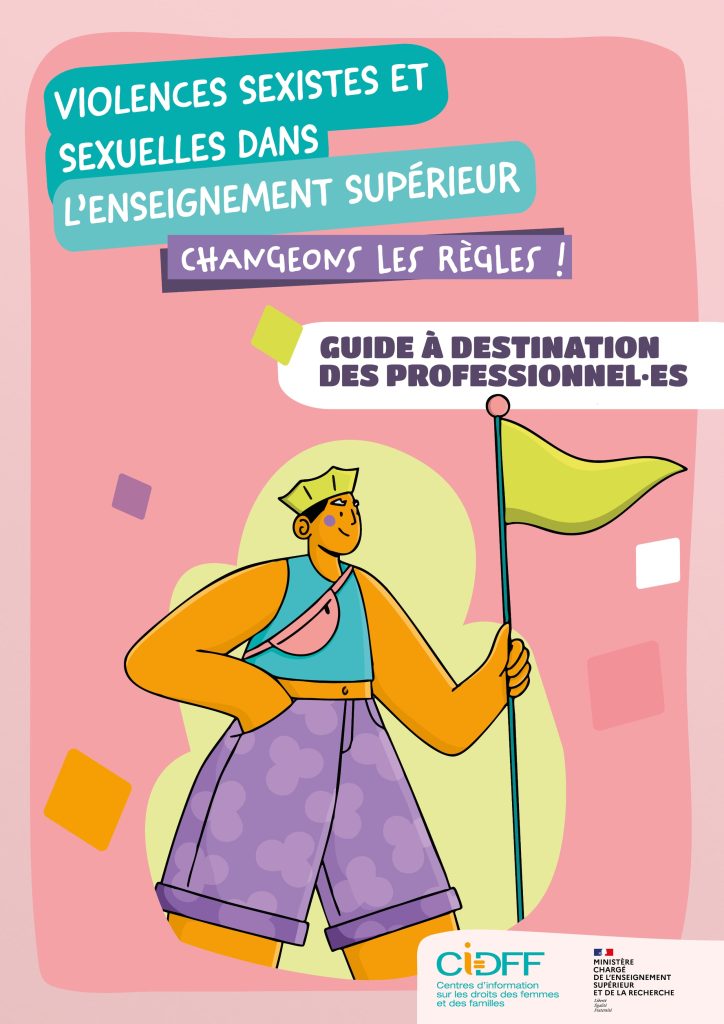Violences
sexistes et sexuelles
dans l'enseignement supérieur,
Changeons les règles

Des outils pour sensibiliser les étudiant·es aux violences auxquelles ils et elles peuvent être exposé·es pendant leurs années d’études et leur donner les ressources pour y faire face.
Ce projet, soutenu par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a été conçu par la Fédération nationale des CIDFF – Centres d’information sur les droits des femmes et des familles.

Sexisme, violences sexistes et sexuelles et culture du viol, de quoi on parle ?
Le sexisme est un système qui valorise le masculin au détriment du féminin. Il alimente des stéréotypes qui peuvent mener à des violences sexistes et sexuelles (VSS) : insultes, harcèlement, agressions, viol, etc.
Ces violences sont largement banalisées en culpabilisant les victimes et en déresponsabilisant les auteurs : c’est ce qu’on appelle la culture du viol.
Elles touchent majoritairement les femmes mais visent toute personne qui s’écarte des normes de genre. Le sexisme forme donc la base des lgbtphobies.
11%
Plus d’1 étudiant·e sur 10 déclare avoir été victime de violence sexuelle depuis son arrivée dans l’enseignement supérieur.

1/3
Plus d’un·e répondant·e sur 3 a été victime ou témoin d’au moins une violence sexiste ou sexuelle lors des événements d’intégration.
20%
Des étudiant·es ont déjà été témoins d’injures lgbtphobes.
Selon l’étude de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur (OBVSS), 2023.
Quelles sont les particularités des violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant ?
L’enseignement supérieur bénéficie souvent d’une image progressiste, avec l’idée que les VSS « ça n’existe pas chez nous ». En réalité les violences y sont présentes, comme partout dans la société. Certains éléments peuvent même les favoriser.
Les relations de pouvoir et académiques
On retrouve beaucoup de rapports de domination prof/étudiant·e, prof titulaire et doctorant·e, tuteur·ice et stagiaire, l’année d’étude, les pouvoirs symboliques (être président·e d’une association), etc. Ces rapports créent des relations qui ne sont pas égalitaires et qui peuvent entraîner des violences.
Les facteurs de vulnérabilité
- l’éloignement géographique et/ou une culture/langue différente (étudiant·es qui partent dans une ville éloignée, étudiant·es étranger·es)
- étudiant·es en situation de précarité. Les étudiant·es qui travaillent en parallèle de leurs études sont plus vulnérables aux pressions.
L’appartenance à des groupes marginalisés
Les personnes racisées, les personnes en situation de handicap ou LGBTI+ sont également davantage exposées aux violences.
Ainsi selon l’OBVSS seulement 1 personne transgenre sur 4 se sent en sécurité dans son établissement.
Les événements festifs et la période d’intégration
Soirées, week-ends d’intégration, afterworks… Les moments festifs peuvent aller de pair avec une forte consommation d’alcool et/ou de drogue. Ces substances peuvent désinhiber, réduire la vigilance, altérer le consentement et l’empathie chez les autres et donc favoriser les violences.
La période d’intégration fait ainsi partie des moments où les étudiant ·es sont le plus exposé·es aux violences.

Comment agir ?
Si je suis victime
Si tu es concerné·e par des violences, même anciennes tu peux :
- Noter ce dont tu te souviens (même si tu n’es pas sûr·e)
- En parler à une personne de confiance
- Contacter une association ou la cellule VSS de ton établissement / te faire accompagner dans un lieu d’écoute / contacter un CIDFF
Depuis 2019 les établissements publics (incluant les universités et grandes écoles publiques) ont l’obligation d’avoir un dispositif de signalement des VSS. Tu peux te renseigner auprès de ton établissement ou bien chercher sur la cartographie du Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche qui les recense, tu la trouveras dans l’espace Ressources.

Et si je suis témoin ?
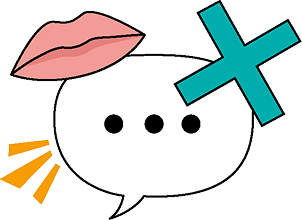
Distraire
Créer une diversion pour couper la situation (ex : faire semblant de connaître la personne, changer de sujet, renverser son verre…).


Déléguer
Chercher de l’aide (un·e ami·e, un·e référent·e, un·e vigile…).


Documenter
Noter ou filmer ce qui se passe, si c’est utile pour la personne concernée (attention à la confidentialité).


Diriger
S’adresser directement à la personne victime :
« Ça va ? Tu veux que je reste avec toi ? »


Dialoguer
En parler après avec la victime, que ce n’était pas normal, que ce n’était pas sa faute et qu’elle n’est pas seule.
Et si on me confie une situation de vss ?
“Je te crois”

Cela permet de reconnaître les violences qu’elle a vécues et de ne pas les remettre en question
“Oh ça m’étonnerait venant de lui !”
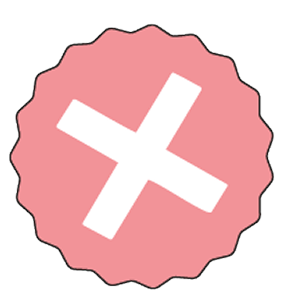
Ne déresponsabilise pas l’agresseur
“Mais t’es sûr·e?”
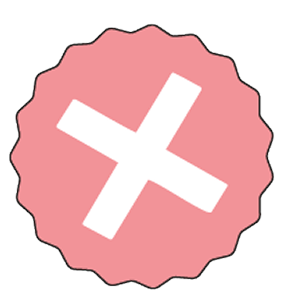
Ne remets pas en cause le récit de la victime
Apprendre à construire des relations saines basées sur le consentement !
Pendant les études, beaucoup de jeunes vivent leurs premières relations amoureuses ou sexuelles. Il est essentiel d’apprendre à les construire de façon saine, en se basant sur le consentement.
Le consentement, ce n’est pas juste « ne pas dire non », c’est pouvoir affirmer des oui R.É.E.L.S :
Réversible, Eclairé, Enthousiaste, Libre et Spécifique.
Être en couple, avoir déjà eu des relations sexuelles avec une personne, être en train d’avoir une relation sexuelle avec quelqu’un, ne signifient pas que tout est permis. Chacun·e peut rompre son consentement à tout moment.
Une relation saine, c’est :
- se sentir respecté·e et écouté·e
- pouvoir être soi-même
- communiquer librement, y compris quand on n’est pas d’accord
- se sentir en sécurité physiquement et émotionnellement
- respecter les limites de chacun·e
- se faire confiance

Au contraire certains comportements sont parfois banalisés dans les relations, notamment chez les jeunes :
- jalousie excessive
- contrôle (du téléphone, des sorties)
- culpabilisation
- insultes
- chantage affectif
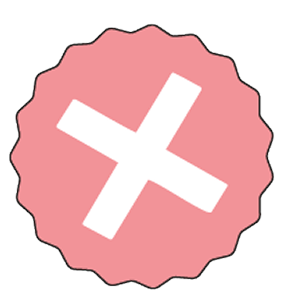
Dans tes relations tu dois pouvoir poser tes limites, dire non, sans avoir peur de l’autre et/ou de ses réactions.
La boîte à outils
Télécharge et diffuse les outils de la campagne “Changeons les règles” !
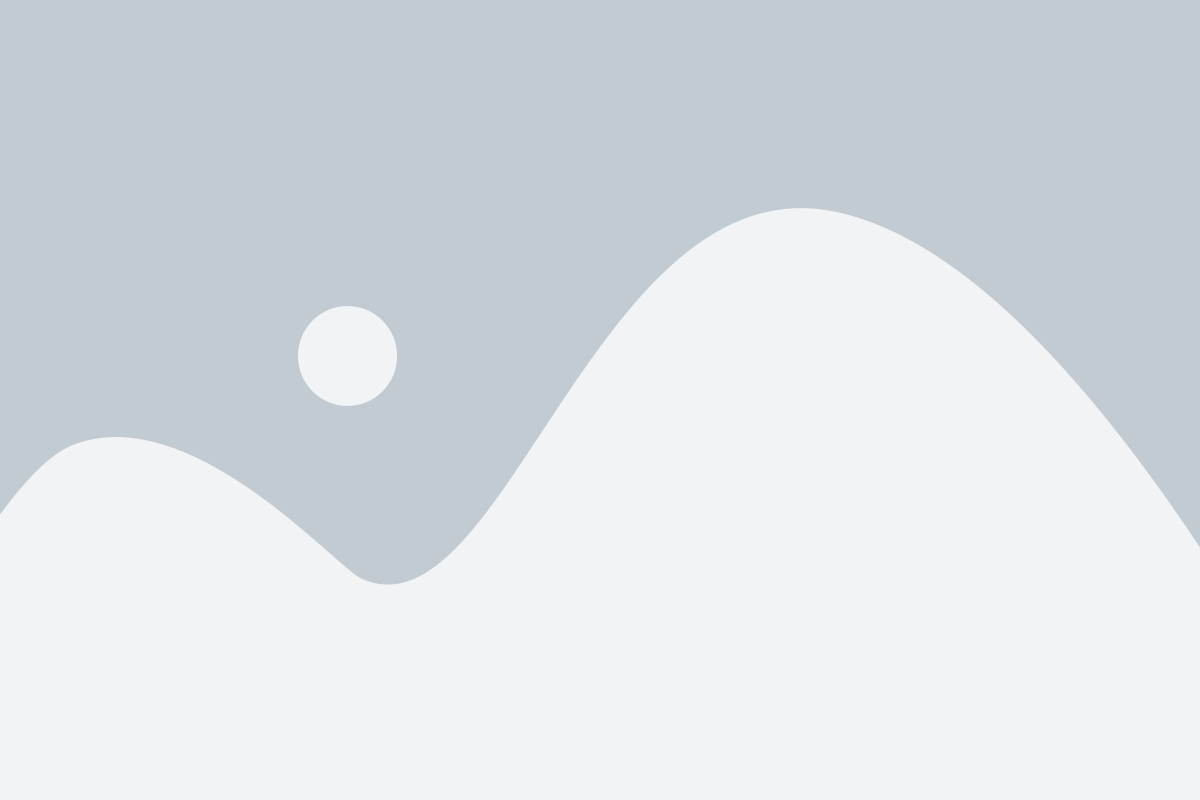
Le jeu de cartes
Dans le cadre de ce projet un jeu de cartes de sensibilisation a été créé. Il peut s’utiliser comme un jeu de cartes classique ou bien comme un outil de prévention, en autonomie ou lors d’ateliers de sensibilisation.
Les CIDFF, c’est quoi ?
Les CIDFF – Centres d’information sur les droits des femmes et des familles – informent et accompagnent les femmes partout en France pour favoriser l’autonomie, l’accès au droit et l’insertion socio-économique. Ils mettent en place des actions multiples et ciblées pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes et entre les genres ainsi qu’une vision féministe de la société.
Dans ces centres tu peux t’informer gratuitement, et de manière confidentielle, sur tes droits auprès de professionnel·les pluridisciplinaires : juristes, psychologues, conseiller·es en insertion professionnelle, etc.

Trouve le CIDFF le plus proche de chez toi !
D’autres contacts et ressources utiles
En cas d’urgence ou de danger imminent
- RDV sur le site « arrêtons les violences »., le portail de signalement gratuit, anonyme et disponible 24h/24 7j/7
- Contacter le 17 pour joindre la police ou la gendarmerie
- Contacter le 114 pour joindre par SMS les services de police et de gendarmerie (quand on ne peut pas parler)
- 15 pour joindre le SAMU
- 18 pour les pompiers
- 112 Numéro d’appel d’urgence européen
Besoin d’en parler à quelqu’un ?
- Contacter le 3919, le numéro national d’écoute et d’orientation à destination des femmes victimes de violences
- Contacter la CNAE, dispositif d’écoute, d’accompagnement et de signalement pour les étudiant·es qui vivent des situations de mal-être, de violence ou de discrimination par téléphone : 0 800 737 800 ou par mail : cnae@enseignementsup.gouv.fr

Trouver sa cellule VSS
- La cartographie du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui recense les cellules de lutte contre les violences sexistes et sexuelles